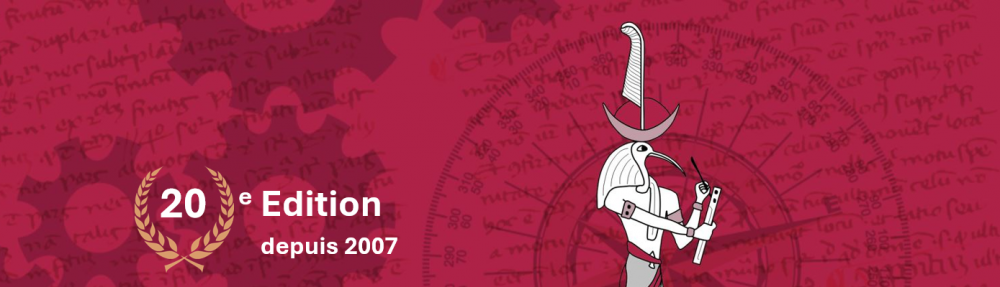Conférence d’ouverture 2025
Titre : « Nos langues nous trompent-elles ? Du topos de l’imperfection des langues aux concepts de « travail de langue » et de « synchronisation » »
Vincent Nyckees
Professeur émérite de linguistique, Université Paris Cité & UMR 7597 « Histoire des théories linguistiques » (France)
Professeur émérite de linguistique, Université Paris Cité & UMR 7597 « Histoire des théories linguistiques » (France)
Résumé : Depuis les origines de la réflexion occidentale sur le langage, les langues ont été très souvent dénoncées comme imparfaites, voire comme trompeuses, au regard de la pensée humaine et des exigences logiques élémentaires. Paradoxalement, puisque, en tant que scientifiques, ils entendent se situer au-delà de tout jugement de valeur sur leur objet, les linguistes réactivent de temps à autre ce topos de la non fiabilité des langues, quoique sur un mode atténué et sans en avoir une claire conscience, lorsqu’ils opposent langue et connaissance et prétendent illustrer les discordances entre ces deux ordres. Il est vrai qu’ils ne font par là que s’inscrire dans une tendance ancienne de leur discipline, puisque, dans leur souci d’affirmer la spécificité des systèmes linguistiques, nombre de linguistes, depuis la fin du XIXe siècle, ont jugé nécessaire de les affranchir de toute obligation de conformité avec les contenus de la connaissance positive, celles de la science en particulier.
Parmi les différentes formes de ce que l’on pourra appeler le discordantisme, je m’attacherai essentiellement dans cette conférence au discordantisme épistémique, selon lequel la langue ou les langues serai(en)t porteuse(s) en tant que telle(s) de représentations s’écartant des connaissances positives ou, à tout le moins, s’accordant mal avec celles-ci. Mon objectif ne sera pas de retourner purement et simplement les termes du débat en démontrant qu’en réalité les représentations collectives dont seraient porteuses les langues s’accorderaient avec la connaissance rationnelle. Je tenterai plutôt de montrer que, si elle peut trouver une justification pratique au regard des impératifs spécifiques des formalismes logiques, cette opposition – ordinaire en linguistique, en logique et en philosophie – entre un ordre des représentations portées par les langues et un ordre de la connaissance rationnelle procède d’une méprise profonde sur le mode d’existence des compétences linguistiques et des compétences épistémiques et que, si on la replace à sa juste échelle, c’est-à-dire à l’échelle individuelle, la question du rapport entre langue et connaissance se présente sous un tout autre jour. Force sera ainsi de constater qu’en réalité une langue n’est jamais ni mieux ni moins bien faite que la pensée des individus qui la parlent.
J’appuierai ma démonstration sur l’examen de deux textes représentatifs du discordantisme épistémique, l’un dû à Benveniste (manuscrit cité par Laplantine, 2020, p. 345-347), l’autre à Copley & Roy (2023). Les analyses que je présenterai sont nées des besoins spécifiques de la théorie « médiationniste » de la signification que je développe depuis les années 2000, et c’est cette approche qui me permettra de reprendre sur d’autres bases la question des relations entre langue et connaissance. Il conviendra en particulier de distinguer nettement la langue empirique – le français d’aujourd’hui par exemple, au sens ordinaire de cette expression – de ce que l’on peut appeler la langue individuelle, c’est-à-dire la synthèse de la langue de son ou, plutôt, de ses groupes que chaque sujet doit nécessairement élaborer à son propre usage tout au long de sa vie aux fins de ses interactions avec autrui et de sa compréhension du monde. Lieu de nos opérations cognitives les plus structurées, la langue individuelle apparaît ainsi comme le plan même sur lequel, dès son plus jeune âge, chacun organise son monde cognitif et se trouve de ce fait obligé de mettre en cohérence (de « synchroniser »), dans la mesure de ses moyens et de ses besoins, sa propre compréhension (toujours lacunaire) de la langue de son groupe avec sa propre expérience du monde (elle-même profondément sémiotisée).
Parmi les différentes formes de ce que l’on pourra appeler le discordantisme, je m’attacherai essentiellement dans cette conférence au discordantisme épistémique, selon lequel la langue ou les langues serai(en)t porteuse(s) en tant que telle(s) de représentations s’écartant des connaissances positives ou, à tout le moins, s’accordant mal avec celles-ci. Mon objectif ne sera pas de retourner purement et simplement les termes du débat en démontrant qu’en réalité les représentations collectives dont seraient porteuses les langues s’accorderaient avec la connaissance rationnelle. Je tenterai plutôt de montrer que, si elle peut trouver une justification pratique au regard des impératifs spécifiques des formalismes logiques, cette opposition – ordinaire en linguistique, en logique et en philosophie – entre un ordre des représentations portées par les langues et un ordre de la connaissance rationnelle procède d’une méprise profonde sur le mode d’existence des compétences linguistiques et des compétences épistémiques et que, si on la replace à sa juste échelle, c’est-à-dire à l’échelle individuelle, la question du rapport entre langue et connaissance se présente sous un tout autre jour. Force sera ainsi de constater qu’en réalité une langue n’est jamais ni mieux ni moins bien faite que la pensée des individus qui la parlent.
J’appuierai ma démonstration sur l’examen de deux textes représentatifs du discordantisme épistémique, l’un dû à Benveniste (manuscrit cité par Laplantine, 2020, p. 345-347), l’autre à Copley & Roy (2023). Les analyses que je présenterai sont nées des besoins spécifiques de la théorie « médiationniste » de la signification que je développe depuis les années 2000, et c’est cette approche qui me permettra de reprendre sur d’autres bases la question des relations entre langue et connaissance. Il conviendra en particulier de distinguer nettement la langue empirique – le français d’aujourd’hui par exemple, au sens ordinaire de cette expression – de ce que l’on peut appeler la langue individuelle, c’est-à-dire la synthèse de la langue de son ou, plutôt, de ses groupes que chaque sujet doit nécessairement élaborer à son propre usage tout au long de sa vie aux fins de ses interactions avec autrui et de sa compréhension du monde. Lieu de nos opérations cognitives les plus structurées, la langue individuelle apparaît ainsi comme le plan même sur lequel, dès son plus jeune âge, chacun organise son monde cognitif et se trouve de ce fait obligé de mettre en cohérence (de « synchroniser »), dans la mesure de ses moyens et de ses besoins, sa propre compréhension (toujours lacunaire) de la langue de son groupe avec sa propre expérience du monde (elle-même profondément sémiotisée).
Biographie : Vincent Nyckees (vincent.nyckees@u-paris.fr) est professeur émérite de linguistique à l’Université Paris Cité et membre du laboratoire HTL (UMR 7597). Depuis La sémantique (Belin, 1998), ses travaux s’inscrivent pour la plupart dans le cadre d’une approche médiationniste de la signification qu’il a développée afin de résoudre certains problèmes majeurs de théorie sémantique (sur cette approche, cf. notamment « Sémantique médiationniste », dans A. Biglari & D. Ducard (dirs.), 2022 et « Comprendre l’autre comme soi-même ? Pour un modèle médiationniste de l’intercompréhension linguistique », Signifiances (Signifying), 5(1), 2021). Vincent Nyckees s’est intéressé en particulier aux relations entre langage et cognition, au changement sémantique, à la catégorisation sémantique, au sens figuré et à la polysémie, à la subjectivité langagière, à l’implicite, à l’intercompréhension linguistique, à la sémantique cognitive et au saussurisme. Il partage actuellement ses recherches entre des travaux d’histoire des théories de la signification linguistique et la préparation d’un ouvrage rassemblant et illustrant les propositions médiationnistes.